Film d’horreur mexicain réalisé en 2022 par Michelle Garza Cervera, Huesera: The Bone Woman est une œuvre qui vous saisit à la gorge pour ne plus jamais desserrer l’étreinte. À la fois cauchemar corporel et drame existentiel, le film s’inscrit dans une veine résolument contemporaine du cinéma d’horreur féministe, aux côtés de The Babadook (2014), Hereditary (2018) ou encore Rosemary’s Baby (1968), tout en affirmant une voix singulière, enracinée dans les tensions sociales et spirituelles du Mexique.
Auréolé du prix de la mise en scène au Festival de Tribeca et projeté dans de nombreux festivals de genre, Huesera s’impose comme un cri silencieux, une fracture à l’intérieur du corps féminin, qu’on observe lentement se fissurer sous la pression des attentes, des regards, des traditions. Ici, l’horreur n’est pas un monstre tapi sous le lit, mais un choix impossible : celui d’être mère quand le cœur aspire ailleurs.

Le film raconte l’histoire de Valeria, jeune femme amoureuse, enceinte, en apparence comblée. Tout semble aller pour le mieux : un compagnon aimant, une famille bienveillante, une grossesse désirée. Et pourtant… Des craquements dans les os, des silhouettes dans les ombres, des visions troublantes viennent s’immiscer dans son quotidien. À mesure que les jours passent, Valeria doute, suffoque, se décompose. L’angoisse grandit. Et avec elle, un souvenir refoulé : Octavia, ancienne amante, liberté oubliée.
Huesera dresse ainsi le portrait d’une femme écartelée entre deux vies : celle qu’elle a choisie, et celle qu’elle s’efforce de jouer. Tiraillée entre maternité imposée et désir de soi, Valeria s’enfonce dans une spirale de paranoïa, d’hallucinations et de douleurs. Les craquements de ses os deviennent les symptômes d’une rupture plus profonde : celle d’une femme qui refuse de disparaître derrière le masque de la mère parfaite.
À travers ce récit viscéral, Michelle Garza Cervera propose bien plus qu’un film de genre : Huesera est un rituel de libération, un geste artistique fort, où l’horreur devient un moyen de questionner les normes, les rôles, les carcans. Un film qui parle aux femmes, mais aussi à toutes celles et ceux qui ont déjà ressenti le vertige d’une vie trop étroite.
À l’occasion d’un échange par mail, la réalisatrice est revenue pour nous sur la genèse du film, son rapport au mythe de La Huesera, ses influences et ses combats. Rencontre avec une cinéaste pour qui le cinéma n’est pas une consolation, mais un exorcisme.
Interview de la réalisatrice Michelle Garza Cervera
Comment est née l’idée de Huesera ? Qu’est-ce qui vous a menée vers cette histoire ?
Je travaille depuis longtemps dans les genres de l’horreur et de la science-fiction, surtout à travers mes courts-métrages. Et très tôt, j’ai compris à quel point ces genres sont puissants pour aborder des sujets sensibles, des tabous, des douleurs sociales qu’on ne peut pas toujours dire en face. L’horreur permet de parler de ce qui fait peur, non pas parce que c’est surnaturel, mais parce que c’est profondément humain. Pour moi, c’est un terrain de liberté incroyable.
Quand j’ai découvert le mythe de La Huesera, cette femme qui collecte des os dans le désert pour faire renaître la vie, j’ai été bouleversée. Ce récit m’a semblé parfaitement refléter les processus douloureux et transformateurs que nous traversons parfois pour retrouver quelque chose de vital en nous. C’est devenu l’ossature du film.
Pourquoi avoir choisi de parler de maternité, et plus précisément d’en faire une matière d’horreur ?
La maternité était centrale dès le début. Ce projet est né à un moment très particulier de ma vie, marqué par une histoire familiale intime. J’ai ressenti le besoin urgent de raconter ce que ça signifie vraiment, profondément, de devenir mère, ou de ne pas vouloir le devenir.
Au Mexique, on voit très rarement des films d’horreur qui abordent la maternité sous un angle aussi critique et intime. Nous voulions vraiment explorer les questions de genre, d’identité, mais aussi dénoncer les pressions qui pèsent sur le corps des femmes. Et l’horreur était le seul langage qui me permettait de dire tout cela à la fois, sans détour, sans édulcorer. Par Valeria, le personnage principal, j’ai voulu interroger l’image de la femme « maudite » simplement parce qu’elle dévie de la norme. Pour moi, l’horreur habite nos maisons, nos berceaux, nos silences. Mais c’est aussi là que l’on peut trouver une forme d’espoir.
Quelles ont été vos influences pour écrire et mettre en scène Huesera ?
Il y en a eu beaucoup. Du côté du cinéma, je citerais Don’t Look Now (Ne vous retournez pas) de Nicolas Roeg, Jacob’s Ladder (L’Échelle de Jacob) d’Adrian Lyne, et We Need to Talk About Kevin de Lynne Ramsay. Mais c’est surtout la trilogie des appartements de Polanski, c’est-à-dire Rosemary’s Baby, Repulsion et The Tenant, qui m’a marquée. Ce qu’il fait avec la perception, avec l’espace, avec l’effritement psychologique… c’est une référence majeure.
Mais mes inspirations vont au-delà du cinéma. Des artistes comme Louise Bourgeois, Ana Mendieta, Graciela Iturbide, Gloria Anzaldúa ou Maya Goded ont profondément nourri mon approche. Leurs œuvres m’ont appris à habiter le corps, à le rendre signifiant.
Avec Abia Castillo, mon co-scénariste, on a voulu que l’horreur soit incarnée. D’où cette idée de fracture osseuse, qui est à la fois un symbole et une sensation. Ce craquement qu’on entend dans le film, c’est celui d’un monde intérieur qui se brise. Et quand il résonne chez le spectateur, je sais qu’on a touché quelque chose de juste.
Le tournage a-t-il été difficile ? Quels ont été les plus grands défis pour vous ?
Le plus grand défi, ça a été de ne pas abandonner. Il nous a fallu cinq ans pour faire ce film. Cinq ans de réécritures, de recherches de financement, d’attente, de doutes. Ce qui nous a sauvés, c’est l’équipe, une équipe passionnée, patiente, prête à rester dans le texte, dans l’ombre, jusqu’à ce qu’il devienne lumière.
Techniquement, on n’avait pas les moyens d’un gros film. Les scènes avec effets spéciaux ont été très compliquées à tourner. Mais c’est là que le montage et surtout le design sonore ont pris toute leur importance. Ce sont eux qui créent la peur, bien plus que les images parfois.
Vous parlez souvent de votre lien fort avec les actrices du film. Quelle place leur avez-vous donnée dans le processus ?
Une place essentielle. J’ai proposé à certaines d’écrire la biographie de leur personnage, et elles ont plongé dedans avec une intensité magnifique. Mercedes Hernández, Martha Claudia Moreno… ce sont des actrices qui ne se contentent pas d’interpréter, elles habitent le rôle.
Natalia Solián, qui incarne Valeria, a donné une force immense au film. Elle a porté le rôle avec une honnêteté bouleversante. Beaucoup de choix de mise en scène sont nés de nos échanges, de ce qu’elle ressentait. C’est un film collectif, un film de femmes surtout, dans tout ce que cela implique d’écoute et de sororité.
Comment le film a-t-il été reçu ? Et comment vivez-vous cette résonance internationale ?
Avec beaucoup de gratitude. Le film continue à voyager, à être projeté dans des festivals, mais aussi dans des lieux que je n’aurais jamais imaginés : des hôpitaux, des universités, des colloques. Il provoque des discussions, des émotions très fortes, des larmes parfois. Et cela me touche infiniment.
Ce qui me rend fière, c’est qu’il a aussi trouvé son public au Mexique. Le film a été embrassé par des communautés féministes, queer, horrifiques. Il est devenu un texte, un outil, une passerelle. Aujourd’hui, il a sa propre vie, et c’est ce que je trouve de plus beau dans le cinéma.
Quels sont tes projets en ce moment ? Quelles histoires t’attirent aujourd’hui ?
Je travaille actuellement sur l’adaptation d’un roman colombien intitulé Ornamento, écrit par Juan Cárdenas, que je coécris avec Alejandra Moffat, une brillante scénariste chilienne connue pour des films comme La Casa Lobo (The Wolf House) et The Hyperboreans.
J’ai également récemment vendu une idée de série télévisée à Universal, qui sera une adaptation du roman Mandibula (Jawbone) de Mónica Ojeda. La série sera produite par La Corriente del Golfo et Eat The Cat.
Par ailleurs, je viens de réaliser le remake du thriller des années 1990 The Hand That Rocks the Cradle (La Main sur le berceau), un projet dont je suis particulièrement fière.
Ce qui m’anime avant tout, c’est de trouver des personnages qui me passionnent, des figures capables de susciter des conversations profondes et de poser les bonnes questions. Je cherche des projets qui me dérangent, qui me sortent de ma zone de confort. En ce moment, je m’intéresse à quelques nouvelles histoires qui devraient me ramener au genre, et me permettre de continuer à faire de l’horreur en Amérique latine, et surtout au Mexique.




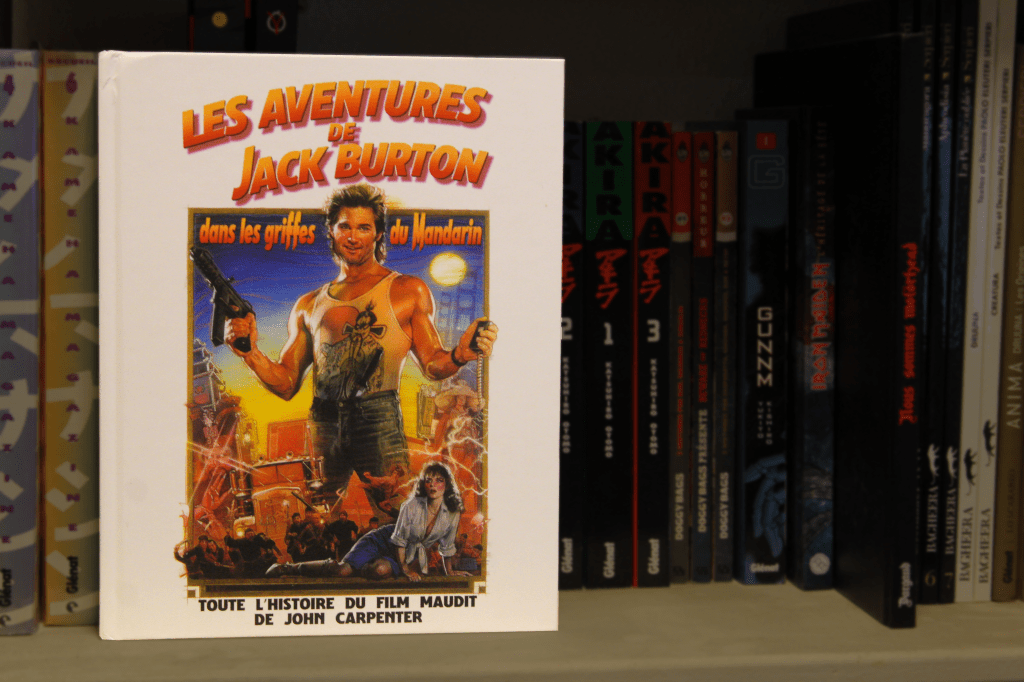




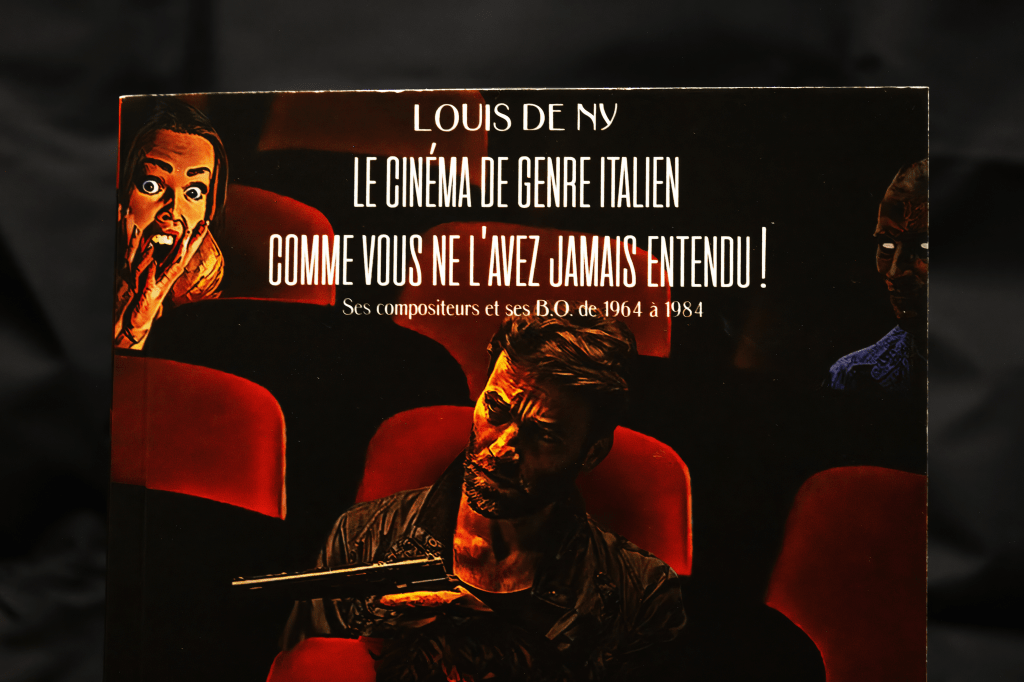

Laisser un commentaire