Avec Inferno, le jeune réalisateur Brandon Gotto, confirme son caractère d’auteur prolifique et sans concession, affirmant ainsi sa place dans le cinéma de genre indépendant belge. Mettant en scène une histoire sombre, le cinéaste donne à son actrice fétiche, Margaux Colarusso, le rôle d’une policière qui décide d’enquêter sur une affaire de disparition de jeune fille, au péril de sa vie !
Pour la sortie récente de son dernier long-métrage, Brandon Gotto a répondu à quelques-unes de nos questions :
Inferno est votre quatrième long métrage. De lui, vous dites qu’il est né de la « nécessité urgente d’affronter l’obscurité ». En quoi est-il différent de vos autres œuvres dans lesquelles vous avez déjà sondé les ténèbres ? Et de même qu’est ce qui pourrait le rapprocher de vos autres films ?
Après Iris, qui se terminait de manière assez lumineuse, j’ai ressenti le besoin de traiter quelque chose d’immensément obscur. Ça m’a frappé comme la foudre. Le montage venait de s’achever et, alors que je réfléchissais déjà à mon prochain film, je me suis souvenu que j’avais toujours désiré faire un polar très noir, en y introduisant mes thèmes récurrents, mes obsessions, etc. À notre époque, avec la parole qui se libère autour des abus et des monstres dissimulés parmi nous, je sentais qu’il y avait quelque chose de très intéressant à explorer. Ce film est différent, car plus ambitieux : davantage de décors, plus de personnages. J’ai reçu le soutien financier de mon ami Vivian Audag, devenu producteur pour ce projet, et tout cela a mis la barre très haut d’emblée pour le tournage. Mais bien sûr, il reste cohérent avec le reste de ma filmographie. L’énergie qui s’y déploie en fait un film “vénère”. Je l’ai voulu comme un coup-de-poing, là où, d’habitude, mes autres films sont un peu plus lents, plus atmosphériques.
Votre film s’inspire de deux sinistres affaires qui ont secoué la Belgique et la France, les affaires Dutroux et Fourniret, et marqués durablement la mémoire collective de ces deux pays. Quels impacts ces deux affaires ont-elles eus sur vous et sur votre travail de cinéaste ? Comment avez-vous traduit cela dans votre film ?
Cela a eu un impact énorme. Dès le départ, à l’écriture du premier jet, je souhaitais inscrire ce polar dans une réalité belge. Et forcément, quand on veut ancrer un tel genre dans une réalité belge, on se retrouve inévitablement confronté à ces deux affaires. Très vite, ça m’a fait vibrer : je me suis senti concerné, encore plus investi que jamais, et surtout, cela me permettait de parler de l’histoire de mon pays. Car, malheureusement, même si ce sont de tristes événements, ils font aujourd’hui partie intégrante de cette histoire.
Le scénario, ainsi que le film, a donc muté en quelque chose de très terre-à-terre, avec une recherche d’authenticité et surtout l’envie de réaliser un film du terroir, issu de nos contrées. Bien sûr, il y a aussi le rapport aux victimes et aux familles des victimes. Je me suis permis de montrer certaines choses, en allant jusqu’à la limite du raisonnable et de ce qui se montre habituellement dans ce genre de film, car je suis persuadé qu’à un moment, il faut prendre le taureau par les cornes, faire en sorte que ce soit impactant, qu’on n’oublie pas. Je me suis permis d’évoquer l’affaire Fourniret et l’affaire Dutroux, car je sais que ma génération peut se le permettre. C’est tellement sensible, tabou et inflammable dans les générations qui me précèdent que très peu ont pu ;ou voulu, en faire un film. Le père de mon producteur est horrifié que nous ayons osé réaliser un tel projet. Pour ma part, je considère que c’est un devoir de mémoire. Le mal est toujours parmi nous. Si ce film peut prévenir et questionner, c’est exactement ce que je cherche.
Inferno se conclut sur un plan montrant le drapeau de la Belgique flottant au vent et dont les couleurs sont ternes, presque délavées, tel un symbole vidé de son sens. Quelle signification avez-vous voulu donner à ce dernier plan ?
Une société qui n’a pas su protéger ses enfants. Un pays dont l’image a été profondément marquée par ces affaires. Et puis, pour le devoir de mémoire : se rappeler qu’il y a eu de telles choses chez nous. Même si c’est horrible, il ne faut pas oublier.
Dans le film, le personnage principal interprété par l’actrice Margaux Colarusso se heurte à sa hiérarchie et à ses collègues policiers. On sait que la rivalité entre les polices belges a fortement impacté de manière significative l’enquête dans l’affaire Dutroux et érodé la confiance que les Belges avaient dans leurs institutions. Était-ce pour vous une manière d’évoquer cette problématique ?
Non, car Maldoror le fait très bien et, même si mon film partage des similitudes évidentes avec celui-ci, je voulais malgré tout en faire une œuvre personnelle, avec une approche différente. Les seuls éléments qui renvoient à ces dysfonctionnements policiers apparaissent “en arrière-plan” : deux filles ont déjà disparu et l’on comprend que la police a déjà des soupçons sur un potentiel coupable, mais qu’elle attend, attend inlassablement avant d’agir. Et, pendant ce temps, une troisième est enlevée.
Dans le synopsis du film, vous dites que « en tant que société, nous devons continuer à regarder là où l’on préfère détourner les yeux ». Est-ce un moyen pour vous d’évoquer les traumatismes collectifs de la Belgique (colonisation, affaires criminelles) qui, comme des malédictions, se transmettent de génération en génération si l’on n’a pas le courage de les affronter ?
Je ne veux pas être celui qui remue le couteau dans la plaie. Malheureusement, c’est le cas. Mais je n’ose même pas imaginer la douleur que doivent ressentir les parents des victimes de ce genre d’affaires chaque fois qu’un film, une série ou un article évoque ce qu’ils ont traversé. Cependant, je pense surtout à la population qui préfère oublier, parce que c’est trop douloureux. Or, ce n’est pas en se voilant la face que les choses s’amélioreront. L’affaire Dutroux n’est que la partie émergée de l’iceberg de ce qui se passe réellement sous la surface de notre pays. Il faut en avoir conscience et agir, chacun à sa manière, comme il le peut.
Certains commentaires sur votre film remettent en cause la légitimité d’un cinéaste à s’emparer d’affaires criminelles telles que celles qui ont inspiré Inferno pour en faire une œuvre audiovisuelle. Pensez-vous que le cinéma doit se contenter de divertir ou a-t-il aussi vocation, sinon a changer les mentalités, mais du moins à faire réfléchir ?
Le film, bien qu’il aborde un sujet tabou, reste divertissant. Je le pense vraiment. C’est un thriller très tendu, conçu comme un polar d’un autre temps, comme on n’en voit plus. Avec en plus une dimension sociétale, qui met la lumière là où ça fait mal. Presque à la manière de Jean-Pierre Mocky, lui qui a toujours placé le message sociétal avant tout. Les deux peuvent bien sûr se concilier. Je trouve même qu’un film est d’autant plus prenant lorsqu’il traite d’un sujet grave, véridique, inspiré de faits réels. Malheureusement, ce n’est pas ainsi que le perçoivent la plupart des spectateurs, plus sensibles à ce genre d’affaires. Pour eux, on exploite le sujet dans un but financier. Mais non : je n’ai pas fait Inferno pour l’argent. Je l’ai fait pour mettre le doigt sur un sujet sensible. Que les gens comprennent cette démarche, voilà la véritable récompense.
Il y a une dans le cinéma belge, une manière d’affronter la violence frontale et radicale comme on peut le voir par exemple dans Maldoror, Megalomaniac ou encore votre film Inferno. Comment expliquez-vous cette spécificité du cinéma de genre belge ?
Ça vient probablement de mes modèles et influences. Des gars comme Gaspar Noé, Fabrice Du Welz ou encore Zack Snyder ont une manière assez radicale de montrer les choses sans se compromettre, ça vient peut-être de ça. Après c’est vrai qu’en Belgique et en Europe bien souvent nous sommes assez punchy. Peut-être, parce que les grandes machines américaines ne nous passent, pas la corde autour du cou. En tout cas, pour ma part, la violence doit être impactante et servir le récit. Cependant, dans mes films, je pense qu’elle est plus psychologique que « juteuse » en matière d’hémoglobine.
Dans Iris comme dans Inferno, vos héroïnes sont des femmes brisées, mais combatives, souvent prisonnières de drames familiaux. D’où vous vient cette fascination pour la résilience dans l’horreur ?
Les femmes, je pense, puisent une force inestimable au fond d’elles-mêmes pour se relever, se battre, affronter l’obscurité. Nous, les hommes, sommes souvent bien plus lâches qu’elles, bien plus faibles. C’est la combativité de certaines femmes qui m’inspire mes personnages principaux féminins. Je pense aussi que cela vient du fait que, à la fin de mon adolescence, je me suis “biberonné” à des films qui mettaient en avant des héroïnes. Et puis durant le lycée, je traînais beaucoup plus avec les filles qu’avec les garçons. La brutalité de certains jeunes hommes, parfois leur vulgarité, m’effrayait un peu. Avec les filles, il y avait quelque chose de plus sérieux, de plus rassurant. Sans doute que tout ce que j’ai pu entendre à cette époque ; parfois pas de très belles choses, a servi de terreau à mes personnages d’aujourd’hui.
Dans le film, on comprend que le couple interprété par Michel Angely et Annick Cornette cache un drame familial qui pourrait expliquer leurs terribles actes, sans les justifier, évidemment. Est-ce pour vous un moyen de donner un fond d’humanité à ces personnages pour ne pas en faire des monstres éthérés ? Une façon d’expliquer l’origine du mal ?
Alors, non justement, c’était ce que je voulais éviter à tout prix. Je ne voulais absolument pas humaniser ces deux personnages. Bien que l’on sente que le personnage d’Annick Cornette est sous l’emprise de Renard, ces deux-là restent des enfoirés. Des écervelés qui se complaisent dans le mal. Il y a bien un événement survenu dans leur passé, lié à Mathilde, mais ce n’est pas censé expliquer ni justifier ce qu’ils font. D’ailleurs, au départ, le scénario comportait un prologue d’une vingtaine de minutes sur la jeunesse de Renard et Chantal. Peu de temps avant le tournage, j’ai décidé de ne pas le tourner, car je trouvais que cela les humanisait trop. Je voulais à tout prix ne pas glorifier le mal, ni donner l’impression qu’on le glorifie. Ces personnages sont ramenés au plus bas de ce qu’ils sont. Heureusement, Michel et Annick ont parfaitement compris cela et se sont pleinement investis dans cette banalité absolue du mal.
Vous collaborez souvent avec les mêmes actrices/acteurs (Margaux Colarusso, Michel Angely, Annick Cornette). Est-ce important pour vous de travailler avec une troupe qui
partage le même vison que vous du cinéma et plus particulièrement du cinéma de genre ?
Bien sûr, grâce à cela, on travaille vite mais, bien. Chacun est très curieux et impatient de voir à quoi ressemblera le résultat final, et c’est aussi une tranche de vie que l’on partage tous ensemble désormais. Je suis très chanceux d’avoir ces fidèles collaborateurs à mes côtés. Pour ce film, il y a également de nouvelles têtes, de nouvelles rencontres, qui feront très certainement partie des prochains projets, et je m’en réjouis déjà. La troupe s’agrandit en tous cas, oui, chacun est conscient qu’il s’agissait d’un thriller d’horreur et qu’il fallait y aller à fond, pour ne pas tomber dans le ridicule ou dans l’irrespect avec un sujet aussi sensible.
Depuis sa sortie, le film a-t-il été présenté dans des festivals ? Comment a-t-il été reçu par les spectateur·rice·s ?
Alors, à l’heure où je vous écris, le film ne sera vu pour la première fois que la semaine prochaine au Chili, lors du Santiago Horror Film Festival. Les premiers avis tomberont bientôt. En France, la première aura lieu le 18 octobre. J’ai très hâte de savoir comment le public va réagir. Je sais déjà qu’en Belgique, on marchera sur des œufs. Par chance, nous avons la presse avec nous, mais je crains que la plupart des Belges se sentent offensés. Je croise les doigts pour qu’ils comprennent la démarche.
Quels sont vos prochains projets ? Pensez-vous revenir au cinéma d’horreur ou continuer dans le thriller social tel que développé dans vos deux derniers films Iris et Inferno ?
J’ai toujours dit que je ne réaliserais que huit longs-métrages. Si l’on compte Pandaemonium, bien qu’il dure 53 minutes, je le considère comme très important dans ma filmographie. Inferno est le cinquième, il m’en reste donc trois. Un film d’horreur est prévu. Il y aura bien sûr toujours autant de noirceur humaine dans les deux autres films prévus, mais avec le film d’horreur, j’aimerais vraiment explorer le mal à l’état brut. La terreur absolue. Prendre en considération la peur humaine la plus universelle et jouer avec, l’explorer en profondeur. Il s’intitulera Revenant, mais je réaliserai les deux autres avant. En tout cas, Iris et Inferno m’ont fait mûrir et évoluer d’une manière que je n’aurais pas soupçonnée auparavant. Je suis donc ravi et assoiffé de m’y remettre.












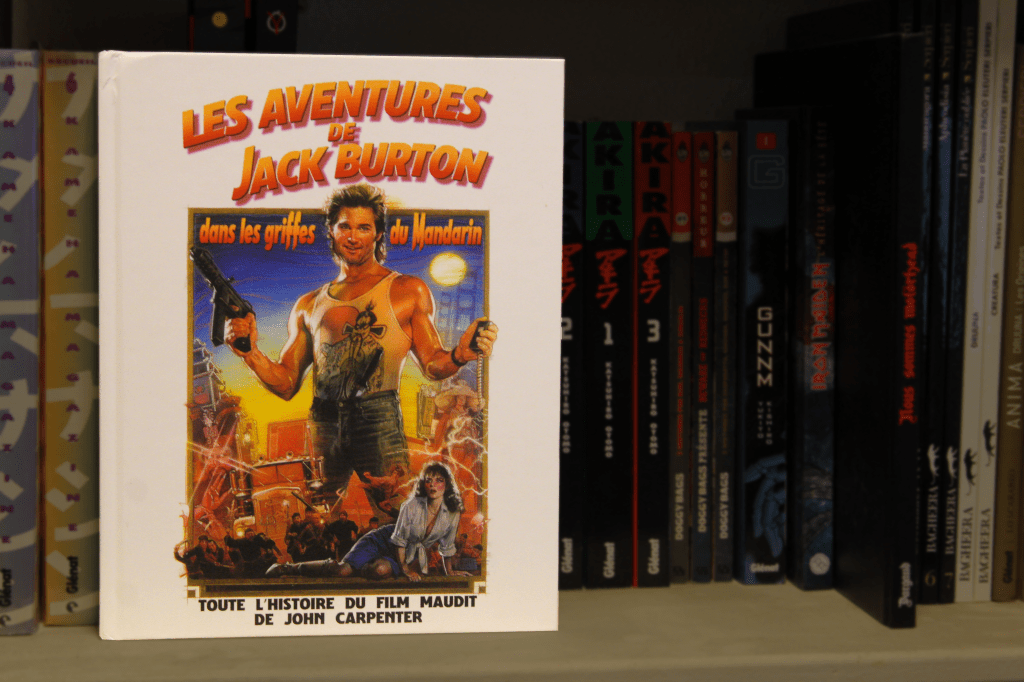

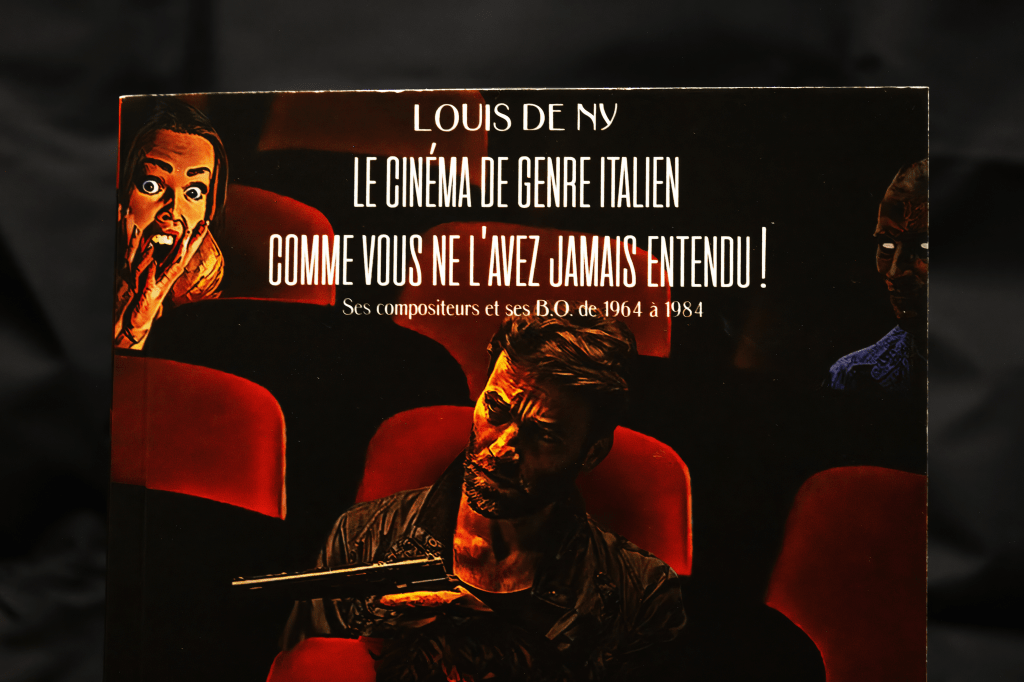


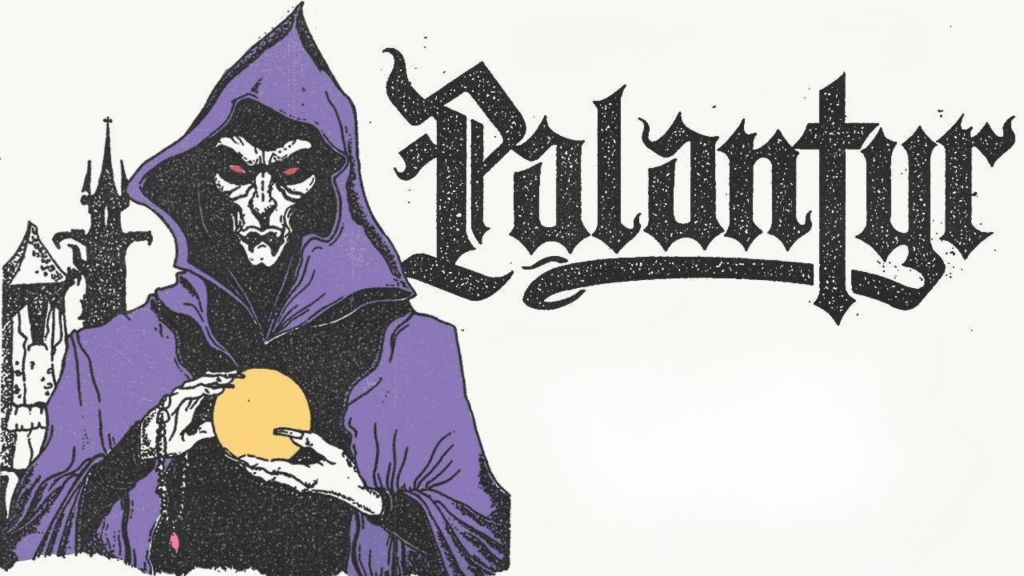









Laisser un commentaire